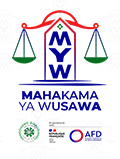Loi n°94-037 du 21 décembre 1994 portant Code de l’eau
Loi n°94-037 du 21 décembre 1994 portant Code de l’eau
Titre 1 – Eaux naturelles
L’eau douce, ressource naturelle renouvelable, fait partie du patrimoine national dont l’Etat est responsable envers la collectivité.
L’Etat fixe les règles auxquelles est soumis le droit d’user et de disposer des eaux.
Le présent Code doit se conformer aux textes réglementaires en vigueur relatifs à la politique nationale de l’environnement.
Chapitre 1 – Eaux de pluie et sources
Art.1.- Eaux de pluie et sources
- Collecte des eaux pluviales
Celui qui recueille et retient les eaux pluviales a un droit d’usage personnel de ces eaux dans le respect des conditions d’hygiène et d’ordre public.
- Servitude d’écoulement
Le fonds inférieur est grevé d’une servitude naturelle d’écoulement des eaux de pluies tom- bant sur le fonds supérieur et des eaux de source nées sur ce fonds.
Si l’usage de ces eaux ou la destination qui leur est donnée aggrave ladite servitude, une in- demnité est due au propriétaire du fond inférieur.
- Restrictions d’intérêt public à l’usage des eaux de source
Le propriétaire d’une source ne peut en user de manière à enlever aux habitants d’une localité voisine l’eau qui leur est nécessaire.
Si, dès la sortie du fonds d’où elles surgissent, les eaux de source forment un cours d’eau ayant le caractère d’eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leur cours naturel au préjudice des usagers situés en aval.
Chapitre 2 – Cours d’eau, eaux souterraines
Art.2.- Domaine public
Les cours d’eau font partie du domaine public, sauf dans les sections déclassées par décret.
Il en est de même de leurs dérivations et des retenues de leurs eaux établies en vue d’assurer la satisfaction des besoins en eau de l’agriculture et de l’industrie, l’alimentation, ainsi que des canaux d’irrigation.
- Conservation du domaine public Le domaine public est inaliénable.
Aucune ouvrage ne peut être exécuté, aucune prise d’eau ne peut être pratiquée sur le domai- ne public sans l’autorisation de l’administration concernée.
Les déversements d’effluents et d’eaux usées dans les cours d’eau sont réglementés par l’autorité de tutelle.
- Gestion du domaine public
La gestion des cours d’eau est assurée par le Ministère chargé de l’énergie, en collaboration avec le ministère du développement rural.
- Eaux souterraines
Les eaux souterraines en nappe de forte profondeur sont soumises à un régime particulier de protection.
Nul ne peut exécuter un puits ou forage destiné au captage d’eau souterraine sans une autori- sation préalable.
Lorsque par des forages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fond, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement.
Titre 2 – Alimentation en eau potable
Chapitre 3 – Qualité des eaux d’alimentation
Art.3.- Dispositions générales
Toute eau livrée à la consommation humaine doit être potable. Elle remplit cette condition lorsqu’elle n’est pas susceptible de porter atteinte à la santé de ceux qui la consomment.
Sont considérées comme eaux destinées à la consommation humaine :
- 1° les eaux livrées à la consommation, conditionnées ou non, y compris les eaux minérales naturelles, réglementées par ailleurs ;
- 2° les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires à des fins de fabrication, de traite- ment, de conservation de produits ou substances et qui ne peuvent affecter la salubrité de la denrée alimentaire finale ;
- 3° la glace alimentaire d’origine hydrique.
Quiconque offre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine, à titre onéreux ou à tire gratuit et sous quelque forme que ce soit, est tenu de s’assurer que cette eau est propre à la consommation.
Même réputée naturellement pure et potable en fonction du milieu où elle est prélevée, l’eau de distribution publique doit faire l’objet d’un contrôle sanitaire constant et d’un traitement adéquat.
Art.3.1.- Caractères bactériologiques et cliniques
Une eau, pour être considérée comme potable et pouvoir être distribuée à une collectivité, doit satisfaire aux conditions suivantes :
- 1° ne pas contenir d’organismes parasites ou pathogènes ;
- 2° ne pas contenir, dans l’eau traitée ou non traitée d’escherilia coi (dans 100 ml d’eau) ni de streptocoques fécaux (dans 50 ml d’eau). La présence en petit nombre, de clostridium sulfito-réducteurs est tolérable dans une eau traitée et n’implique pas à elle seule la non potabilité de l’eau ;
- 3° ne pas présenter de coloration dépassant 20 unités (échelle colorimétrique au platino- cobalt) ni une turbidité supérieure à 15 gouttes de solution alcoolique de gomme mastic à 1/1.000. En période normale d’exploitation et pour une durée limitée, il peut être toléré qu’elle atteigne 30 gouttes de mastic (dans 40 millilitres d’eau optiquement vide) ;
- 4° ne pas avoir un pouvoir colmatant dû aux éléments en suspension supérieur à 0,1 et ne pas contenir d’algues ou autres éléments figurés ;
- 5° ne pas présenter d’indices chimique de pollution ni de concentration en substances toxiques ou indésirables supérieurs à celles qui sont fixées dans le tableau ci-dessous :
- Concentrations limites (en milligrammes par litre) Plomb (en Pb) 0,1 Sélérium (en Sce) 0,05 Fluorure (en F) 1,0 Arsenic (en As) 0,05
- Chrome (hexavalent) Dose inférieure au seuil de détermination analytique Cuivre (en Cu) 1,0 Fer (en Fe) 0,2 Manganèse (en Mn) 0,1 Zinc (en Zn) 5,0 Composés phénoliques (en phénol) néant
- 6° la minéralisation totale ne doit pas excéder 2 g par litre ;
- 7° l’eau ne doit pas présenter une radioactivité supérieure à celle qui est définie par les recommandations de l’OMS. En outre, l’eau ne doit présenter ni odeur, ni saveur désa- gréable.
- 8° il est en outre recommandé que la concentration de certains éléments ne dépasse pas les teneurs suivantes :
- Magnésium (en mg) 125 mg/1
- Chlore (en Cl) 250 mg/1
- Sulfate (en So 4) 250 mg/l
- Nitrate (en NO 3) 44 mg/l
Chapitre 4 – Captages
Art.4.-Points de prélèvements et périmètres de protection
Un point de prélèvement est un captage, un forage, une source, un champ captant ou une prise d’eau de surface.
Plusieurs captages (ou plusieurs forages…) proches les uns des autres, exploités par le même service et pour lesquels les mesures de protection sont communes constituent un seul point de prélèvement.
Art.4.1.- Protection des points de prélèvement
La protection des points de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine qui relève de l’application du Code de la santé publique, se distingue de celle, plus générale, prévue pour les eaux souterraines par la réglementation relative aux déversements, jets, écoulements, dé- pôts directs ou indirects d’eau ou de matière. Il s’agit en fait d’une protection complémentaire dont l’objet est de préserver les points de prélèvement des risques de pollution provenant des activités exercées à proximité.
Cette protection particulière est réalisée par la mise en place de périmètres de protection défi- nis pour un débit maximal de prélèvement et destinés à faire obstacle aux éléments polluants susceptibles d’altérer de façon significative la qualité des eaux. A l’intérieur de ces périmè- tres, certaines activités peuvent être interdites ou réglementées.
La diversité des contextes hydrologique et hydrogéologique et, par conséquent, des phénomè- nes de transfert et de dégradation des substances polluantes, conduit à distinguer, d’une part la protection des captages et des sources d’eaux souterraines et d’autre part, celle des prélève- ments d’eau de ruissellement de surface dans les roches compactes présentant des fissures ouvertes (roches cristallines, gréseuses et surtout calcaires)
Art.4.2.- Protection des captages et sources d’eau souterraines
La protection des points de prélèvement des eaux destinées à la consommation humaine est réalisée par la mise en place de deux périmètres, l’un de protection immédiate, l’autre de pro- tection rapprochée, complétée éventuellement par un troisième périmètre, dit de protection éloignée.
- Périmètre de protection immédiate
Le périmètre de protection immédiate a pour fonction d’empêcher la détérioration des ouvra- ges de prélèvement et d’éviter que des déversements ou des infiltrations de substances pol- luantes se produisent à l’intérieur ou à proximité immédiate du captage.
Compte tenu de l’accroissement général des risques de pollution, il faut préserver un rayon de 50 m au minimum autour du point de prélèvement.
- Périmètre de protection rapprochée
Le périmètre de protection rapprochée doit protéger efficacement le captage vis-à-vis de la migration souterraine des substances polluantes.
Son étendue est déterminée en prenant notamment en compte :
- la durée et la vitesse de transfert de l’eau entre les points d’émission de pollutions possi- bles et le point de prélèvement dans la nappe,
- le pouvoir de fixation et dégradation du sol et du sous-sol vis-à-vis des polluants,
- le pouvoir de dispersion des eaux souterraines.
- Périmètre de protection éloignée
Le périmètre de protection éloignée protégera éventuellement le précédent pour renforcer la protection contre les pollutions permanentes ou diffuses. Il sera créé si l’on considère que l’application de la réglementation générale, comme renforcée, n’est pas suffisante, en particu- lier s’il existe un risque potentiel de pollution que la nature des souterrains traversés ne per- met pas de réduire en toute sécurité, malgré l’éloignement du point de prélèvement.
Art.5.- Protection des captages des eaux de surface
Pour les captages en eaux de surface (cours d’eau, retenues…) la délimitation des périmètres de protection définis par le Code de la santé publique est obligatoire ; la procédure d’établissement de ces périmètres est tout à fait identique à celle décrite ci-dessus.
Toutefois, compte tenu des vitesses de transfert mises parfois en jeu en cas de déversement, accidentel ou non, la sécurité de l’approvisionnement en eau est assurée essentiellement par :
- 1° l’existence d’équipements de traitements des eaux adaptés aux caractéristiques des eaux brutes et pouvant absorber les variations de ces caractéristiques ;
- 2° le développement d’une action de prévention portant sur l’inventaire et l’analyse des risques de pollution accidentelle ainsi que sur leur réduction ;
- 3° la mise en place d’un dispositif de surveillance continue et d’alerte ainsi que l’établissement d’un plan d’intervention.
Il est clair cependant que la sécurité et l’approvisionnement seront d’autant mieux assurés que la collectivité disposera d’une alimentation diversifiée permettant de faire appel en cas d’accident, à des ressources de qualité satisfaisante.
La définition des périmètres de protection a pour objectifs :
- d’assurer une protection matérielle efficace du point de prélèvement notamment contre tout rejet ou jet direct dans la zone influencée directement par le pompage des eaux, cette zone pouvant être identifiée à celle du périmètre de protection immédiate ;
- de définir à proximité du point de prélèvement, un périmètre de protection rapprochée où devront être interdits, supprimés ou réglementés de manière spécifique tous les rejets d’eaux usées, tous les dépôts de matières polluantes et toutes les causes de pollution diffu- se, par ruissellement en particulier ; par ailleurs seront proscrits tous les ouvrages de col- lecte et de traitement d’eaux usées et d’évacuation d’effluents traités. Il s’agit ainsi d’éviter que ne se dégrade la qualité des eaux brutes pour laquelle la station de traitement a été conçue.
La création d’un périmètre de protection éloignée n’apparaît que rarement nécessaire. Il sem- ble beaucoup plus judicieux d’intervenir dans le cadre d’une politique d’objectifs de qualité, sur l’ensemble ou sur une partie du bassin versant.
Pour garantir la présence des cours d’eau, la protection des eaux superficielles doit être soute- nue par une politique de protection de la forêt.
Art.5.1.-Cas de prélèvement en cours d’eau
Le périmètre de protection immédiate doit interdire tout accès à la prise à l’usine de traite- ment. Si l’usine n’est pas construite en bordure directe du cours d’eau, deux périmètres sépa- rés doivent être prévus.
Outre la zone voisine de la prise d’eau, le périmètre de protection immédiate peut comprendre une partie du cours d’eau dont les limites sont alors matérialisées pour faire obstacle à la bai- gnade et à la lessive.
Le périmètre de protection rapprochée et, le cas échéant, le périmètre de protection éloignée peuvent s’étendre sur chacune des rives du cours d’eau à l’amont, leurs dimensions étant no- tamment fonction du rapport du débit prélevé au débit d’étiage et des risques de pollutions (eaux usées, ruissellement de versement accidentel à partir du réseau routier…).
Art.5.2.- Réseau de surveillance de la qualité des eaux
A l’intérieur des périmètres de protection, des mesures particulières de surveillance peuvent être établies tant pour suivre l’évolution de la qualité des eaux souterraines par l’implantation d’un réseau de surveillance, que pour évaluer la qualité des rejets d’eaux usées pouvant être à l’origine de pollutions dangereuses.
Le réseau de surveillance de la qualité des eaux souterraines repose sur différents points d’observation de l’aquifère où sont effectués périodiquement des prélèvements d’échantillons d’eau. La surveillance permanente du taux total de minéralisation sera effectuée par la pose d’un appareil de mesure (conductimètre) au fond du puits ou dans son voisinage.
Les analyses des échantillons portent sur des paramètres choisis en fonction de l’existence d’un risque particulier pour lequel il apparaît nécessaire de suivre l’évolution (nitrates par exemple) ou bien d’évaluer l’efficacité de la protection mise en place. La recherche de pesticides peut faire partie d’un programme ; elle reste assujettie à une connaissance préalable des produits utilisés à proximité.
Chapitre 5 – Distribution d’eau potable
Art.6.- Dispositions communes
Sont interdites les amenées par canaux à ciel ouvert d’eau destinée à l’alimentation humaine à l’exception de celles ayant fait l’objet de travaux d’aménagement garantissant que l’eau livrée est propre à la consommation.
L’utilisation d’eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine est autorisée par arrêté conjoint du Ministre de la santé et de celui chargé de l’eau.
Un arrêté conjoint du Ministre de la santé et de celui chargé de l’eau déterminera les modali- tés selon lesquelles la demande d’autorisation sera établie et instruite et indiquera les procédés et produits de traitement techniquement appropriés auxquels il peut faire appel.
N’est pas soumise à la procédure d’autorisation prévue au deuxième alinéa, l’utilisation d’eau prélevée dans le milieu naturel à l’usage personnel d’une famille.
Art.6.1.- Distribution privée
L’embouteillage de l’eau destinée à la consommation publique ainsi que le captage et la dis- tribution d’eau d’alimentation humaine par un réseau privé d’adduction sont soumis à l’autorisation du Ministre de la santé et de celui chargé de l’eau.
Un décret en Conseil des Ministres déterminera les modalités d’application des dispositions du présent chapitre et notamment celles du contrôle de leur exécution ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes ou entreprises visées par lesdites dispositions devront rembour- ser les frais de ce contrôle et celles dans lesquelles l’autorisation pourra être suspendue ou retirée.
Art.6.2.- Distributions publiques
Tout distributeur public d’eau potable est tenu dans les conditions fixées par un règlement d’administration publique de faire vérifier la qualité de l’eau qui fait l’objet de cette distribu- tion.
Les méthodes de correction à mettre éventuellement en œuvre doivent être approuvées par le Ministre de la santé publique et de la population.
Les mêmes obligations incombent aux collectivités en ce qui concerne les puits, sources, nap- pes souterraines ou superficielles ou cours d’eau servant à l’alimentation collective des habi- tants.
En cas d’inobservation par un distributeur des obligations énoncées au présent article, le Mi- nistre chargé de la Santé, après mise en demeure restée sans résultat, prend les mesures néces- saires. Il est procédé à ces mesures aux frais des distributeurs ou des collectivités.
Art.6.3.- Déclaration d’utilité publique
En vue d’assurer la protection de la qualité des eaux, l’acte portant déclaration d’utilité publi- que des travaux de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines détermine, autour du point de prélèvement en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l’intérieur duquel sont interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l’intérieur duquel peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts ci-dessus visés.
Un décret en Conseil des Ministres déterminera les conditions d’application de l’alinéa précé- dent.
L’acte portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines détermine, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations existants à la date de sa publication, les délais dans lesquels il devra être satisfait aux conditions prévues par le présent article.
Des actes déclaratifs d’utilité publique peuvent, dans les même conditions, déterminer les périmètres de protection autour des points de prélèvement existants, ainsi qu’autour des ou- vrages d’adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés.
Art.6.4.-Indemnités d’expropriation
Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants des terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon des règles applicables en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.
Art.6.5.- Exigences de qualité
Au lieu de leur mise à disposition de l’utilisateur, les eaux destinées à la consommation hu- maine doivent satisfaire aux exigences de qualité définies dans la présente loi. Par ailleurs, elles ne doivent pas présenter de signe de dégradation de leur qualité.
Art.6.6.- Contrôle sanitaire
Le contrôle de la qualité des eaux en cours d’exploitation est exercé par le distributeur sous le contrôle des services compétents du ministère chargé de la santé publique. Les analyses sont faites par un laboratoire indépendant légalement reconnu.
Les produits de traitement devront être conformes aux normes de l’OMS et être accompagnés d’un certificat d’origine.
Le Ministre de la santé aura le droit d’interdire l’utilisation de certains produits jugés nocifs.
Titre 3 – Régime du service public de l’eau
Chapitre 6 – Caractères du service public
Art.7.- Objet du service public
Le service public de l’eau a pour objet le captage, l’adduction et la distribution d’eau potable qui, réunis dans un même périmètre en unité d’exploitation, forment une distribution publi- que.
Chapitre 7 – Gestion du service public
Art.8.- Gestion du service public
Art.8.1.- Structure de gestion
L’Etat confie la gestion du service public de l’eau à l’EEDC.
A ce titre l’EEDC exploite les grands et moyens réseaux d’adduction sur l’ensemble du terri- toire national. Elle élabore et met en œuvre les programmes et projets de renforcement et d’extension de ces réseaux ainsi que les programmes et projets d’alimentation des centres urbains.
Art.8.2.- Exploitation des ouvrages appartenant à des tiers
- A la demande des collectivités locales ou par exercice du droit préférentiel attaché à sa mission de service public, l’entreprise peut prendre en charge l’exploitation d’une distribution publique créée en dehors de son intervention et ce dans les mêmes conditions que ses propres installations, dès lors qu’il n’en résulte pas des sujétions anormales et des coûts exceptionnels susceptibles de nuire à son équilibre financier.
- Les petites adductions semi-urbaines et rurales sont du ressort du Ministre chargé de la production.
Titre 4 – Aménagement des ressources en eau
Chapitre 8 – Travaux sur les cours d’eau
Art.9.- Ouvrages de prise d’eau, de dérivation et de retenue
L’établissement de prises d’eau, de dérivations et de retenues sur les cours d’eau en vue no- tamment de l’approvisionnement domestique ou industriel et de l’irrigation, doit faire l’objet d’une demande d’autorisation adressée au Ministre chargé des ressources en eau en fournis- sant toutes indications sur les caractéristiques de l’aménagement projeté, ses justifications, ses modes de financement et d’exploitation.
L’autorisation accordée fixe notamment les caractéristiques de l’ouvrage, les conditions d’exécution des travaux, le débit maximal à utiliser et le débit réservé en aval, ainsi qu’éventuellement les conditions d’exploitation.
Les ouvrages existants sont soumis à déclaration de leurs caractéristiques auprès des autorités compétentes dans les six mois qui suivront la publication du présent Code.
Art.9.1.- Utilisation de l’énergie hydraulique
Nul ne peut disposer de l’énergie d’un cours d’eau sans une autorisation de l’Etat.
Les barrages, retenues et usines hydrauliques sont autorisés, quelle qu’en soit la puissance, par décret pris en Conseil des Ministres, sur la proposition du Ministre chargé de l’équipement et de l’énergie.
La durée des autorisations ne peut être supérieure à cinquante ans. A toute époque, elles peu- vent être révoquées ou modifiées sans indemnité.
Dans les cinq ans qui précèdent leur expiration, elles peuvent être renouvelées pour une durée de trente ans. Un droit de préférence appartient au permissionnaire dont le titre vient à échéance.
Le renouvellement s’opère de plein droit pour ladite durée de trente ans si l’administration ne notifie pas de décision contraire avant le commencement de la dernière année.
Si l’autorisation n’est pas renouvelée, le permissionnaire est tenu de rétablir le libre écoule- ment du cours d’eau ; toutefois, l’Etat a la faculté d’exiger l’abandon, à son profit, des ouvra- ges de barrage et de prise d’eau édifiés dans le lit du cours d’eau et sur ses barrages, le tout avec indemnité.